Histoire de Paris par Fernand Bournon
Accueil - Cartes postales anciennes - Les artisans du patrimoine - Monumentum
XIX. La guerre de 1870
Origine de la guerre. — Le 4 septembre. — Paris investi. —Premiers combats. — Départs en ballon. — Combats du Bourget. — Refus d'armistice. — Bataille de Champigny. — Rigueurs du siège. — Paris bombardé. — Combat de Buzenval. — Capitulation de Paris. — Parisiens célèbres du dix-neuvième siècle. — Paris sous la troisième République.
Origine de la guerre.
La candidature d'un prince de la maison de Hohenzollern au trône d'Espagne faillit en être le prétexte. L'Allemagne, de son côté, désirait la guerre, mais ne voulait pas la provoquer. Par une habile condescendance, elle renonça à soutenir le prince de Hohenzollern. Mais, connaissant l'état des esprits à la cour des Tuileries, elle savait que le moindre incident, facile à susciter, mettrait le feu aux poudres. Une prétendue injure faite à M. Benedetti, alors notre ambassadeur en Prusse, par le roi Guillaume, sur la promenade d'une ville d'eaux, fut saisie comme une occasion favorable par le cabinet des Tuileries. L'impératrice exerça, en cette occasion comme en beaucoup d'autres, une influence néfaste sur l'esprit de l'empereur, vieilli et affaibli par la maladie.
Le premier engagement entre les troupes françaises et allemandes eut lieu près de Forbach et sur les hauteurs de Spickeren. Le résultat, escompté à Paris comme une victoire, resta indécis. Malheureusement, il ne devait pas en être ainsi dans la suite. Les sanglantes défaites de Wissembourg, de Reischoffen, de Borny et de Gravelotte devaient être suivies de près par celle de Sedan, où l'empereur fut fait prisonnier avec tout le corps d'armée. La trahison de Bazaine, qui avait immobilisé dans Metz une armée entière, mit le comble à notre mauvaise fortune.
Le 4 septembre.
La nouvelle du désastre de Sedan jeta la consternation dans Paris. Mais après le premier mouvement de stupeur, la foule se porta au Corps législatif et envahit la salle des séances, réclamant la déchéance de l'empire. Les députés de Paris parvinrent à calmer cette effervescence en se rendant à l'Hôtel-de-Ville, où le peuple les suivit. Un gouvernement provisoire, composé de quelques-uns des députés de la Seine, fut immédiatement constitué, et son premier acte fut de proclamer la République.
C'était une révolution, mais une révolution pacifique. La conduite du peuple de Paris fut admirable ; pas un excès ne fut commis. Le nouveau gouvernement prit le titre de Gouvernement de la Défense nationale. Le général Trochu, gouverneur de Paris, en fut nommé président.
Dans cette même journée du 4 septembre, l'impératrice s'enfuit sans être inquiétée. Les Tuileries n'avaient pas été envahies ; tous les édifices furent de même respectés ; on se contenta seulement d'en faire disparaître les aigles impériales, emblème du régime déchu.
Paris Investi.
Cependant l'ennemi marchait sur Paris avec une extrême rapidité. En vain, le gouvernement tenta d'obtenir la paix à des conditions honorables ; en vain, Jules Favre fit remarquer au chancelier allemand que la France n'avait pas demandé la guerre, que seul l'empereur l'avait voulue, que d'autre part la Prusse avait déclaré qu'elle ne faisait la guerre qu'au régime impérial, et que ce régime était tombé. Toute tentative de conciliation échoua. Le 17 septembre, Paris fut complètement investi par les troupes prussiennes. Le roi de Prusse établit son quartier général à Versailles ; trois corps d'armée occupèrent la rive droite de la Seine et toute la région N. et N.-E. de la ville ; le quatrième se détacha des autres à Saint-Denis, franchit la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, et occupa toute la banlieue à une distance de trois lieues des remparts, entre la Marne et la Seine.
Premiers combats.
Le premier combat eut lieu le 18 septembre au plateau de Châtillon. Il ne fut pas heureux ; nos troupes mal disciplinées, notamment un régiment de marche composé d'éléments divers, se mirent en déroule et rentrèrent à Paris dans le plus grand désordre. Cet échec, cependant, n'affaiblit en rien l'esprit de résistance. Les jours suivants, d'autres rencontres eurent lieu également, au sud de Paris, à Villejuif, aux Hautes-Bruyères, à Chevilly, où nous reprîmes l'avantage.
Départs en ballon.
Le cercle de fer qui entourait Paris ne s'en resserra que plus étroitement. Le 7 octobre, Gambetta, un des membres du gouvernement de la Défense nationale, quitta Paris en ballon, espérant aller à Tours et soulever la province, de façon à l'entraîner au secours de Paris ; le vent contraire le conduisit à Amiens, tout à l'opposé ; mais il put néanmoins gagner Tours sans être inquiété. Sur la Loire, il trouva une armée nombreuse, commandée par le général Chanzy, qui, pendant plusieurs mois, combattit vaillamment les Prussiens dans toute la région du centre.
Combats du Bourget. Journée du 31 octobre.
Au nord de Paris, sur la route de Soissons, se trouve le village du Bourget ; l'armée prussienne l'occupait ; elle y fut attaquée très énergiquement, le 28 octobre, et finalement on l'en délogea ; mais le lendemain, l'ennemi, revenu en forces, reprit ses positions après un combat acharné ; nos soldats, cernés de toutes parts, se battirent comme des lions et purent rentrer à Saint-Denis en bon ordre, mais le Bourget était perdu pour nous.
Une nouvelle bien plus grave se répandit en même temps dans Paris ; l'armée de Metz, commandée par le maréchal Bazaine, venait de capituler sans avoir livré bataille. L'indignation des Parisiens ne connut plus de bornes ; dans la journée du 31 octobre, il y eut une manifestation considérable devant l'Hôtel-de-Ville ; on réclamait la guerre à outrance, on protestait contre la faiblesse du gouvernement qui n'organisait pas assez de sorties en masse. Peu s'en fallut que la guerre civile n'éclatât tandis que l'ennemi était a nos portes.
Refus d'armistice.
Quelques jours après, des négociations eurent lieu entre les assiégeants et les assiégés ; on demandait aux Prussiens un armistice de quelques jours, afin de permettre aux Parisiens de faire sortir de la ville les bouches inutiles, femmes, enfants, malades, vieillards. La Prusse refusa : Paris n'en fut que plus résolu à soutenir la lutte jusqu'au bout. Dès lors commença la série des sacrifices héroïques ; le pain, la viande devenaient rares, on n'avait plus le droit de les vendre sans compter : les riches comme les pauvres durent se rationner. La population accepta toutes ces privations sans murmure.
Bataille de Champigny.
Dans les derniers jours de novembre, le gouvernement annonça enfin la grande sortie que les Parisiens réclamaient avec tant d'impatience ; presque toutes les troupes de l'armée de Paris devaient chercher à franchir la ligne des Prussiens du côté du sud-est, entre la Marne et la Seine, et rejoindre l'armée de la Loire vers Fontainebleau. Le général Ducrot, dans une proclamation énergique, déclara qu'il ne rentrerait dans Paris que mort ou victorieux.
Le choc principal des deux armées se fit sur la Marne, à quatre lieues de Paris, dans le village de Champigny. Malgré des pertes considérables de notre coté, l'ennemi fut délogé de ce lieu et Ducrot put passer la Marne. Mais le lendemain, les Prussiens concentrèrent le gros de leurs forces sur ce point et nous forcèrent à repasser le fleuve ; ce fut encore pour Paris une grande déception.
Rigueurs du siège.
Cependant, un froid rigoureux sévissait, et l'hiver semblait conspirer avec l'ennemi contre les Parisiens. Pendant tout le mois de décembre la neige couvrit le sol ; le thermomètre descendit à vingt degrés au-dessous de zéro. Rien cependant ne décourageait les assiégés, ni le froid, ni la faim qui devenait maintenant un réel supplice ajouté à toutes les angoisses du siège ; les boulangers ne pouvaient plus livrer à chaque habitant que quelques centaines de grammes d'un pain d'où la farine était complètement absente ; la viande de boucherie faisait défaut : on en fut réduit à manger de la chair de cheval, d'âne, et même des rats.
Il y eut, pendant ce mois de décembre, quelques combats peu importants et dont l'issue ne modifia en rien la situation ; le plateau d'Avron, que nos soldats occupaient, dut être abandonné par eux.
Paris bombardé.

Une scène du bombardement à Paris.
Bientôt la nouvelle se répandit que l'ennemi ne se bornerait pas à bombarder les forts et les remparts, mais que ses obus viendraient frapper la ville même, si la résistance se prolongeait. La nouvelle était vraie ; le 9 janvier, quelques obus, lancés des hauteurs de Châtillon, franchirent les fortifications et tombèrent à Montrouge ; le bombardement continua les jours suivants, ou, pour mieux dire, les nuits suivantes, et dura jusqu'au 21 janvier. On n'a pas oublié la nuit du 8 au 9 janvier pendant laquelle les obus s'abattirent sur toute la rive gauche, dans la zone comprise entre le Jardin des Plantes et la place Saint-Germain-des-Prés ; les habitants de ces quartiers subirent cette nouvelle épreuve aussi stoïquement que les précédentes ; ils se résignèrent à passer les nuits dans leurs caves. Le bombardement fit un certain nombre de victimes, sans démoraliser toutefois une population plus que jamais décidée à la résistance.
Combat de Buzenval.
Le gouvernement se décida à organiser l'attaque suprême que Paris réclamait de plus en plus : il fut décidé qu'elle aurait lieu sur les hauteurs voisines de Saint-Cloud, de façon, à ce que nos forces, en cas de succès, pussent atteindre Versailles et attaquer le quartier général du roi de Prusse. Toutes les troupes furent concentrées sur Buzenval, qui était, entre Saint-Cloud et Garches, le point central des opérations. La bataille eut lieu le 19 janvier et fut des plus acharnées ; mais les Prussiens avaient eu le temps de se fortifier sur la colline, et cette position leur permit de repousser nos soldats, qui ne gravissaient les hauteurs qu'avec peine dans un terrain détrempé par le mauvais temps. Ce fut encore une défaite, et la plus cruelle de toutes, car elle nous coûta beaucoup de vaillants défenseurs, et le découragement commença à gagner même les plus résolus. C'est à Buzenval que furent tués un jeune peintre de grand talent, Henri Regnault, et le vieux marquis de Coriolis, qui s'était engagé comme simple volontaire dans un bataillon de marche de la garde nationale malgré ses soixante-dix ans.
Capitulation de Paris.
Paris n'avait plus de pain que pour quelques jours. Il fallut capituler : un armistice fut conclu le 28 janvier 1871, afin de permettre le ravitaillement de la capitale et la convocation à Bordeaux d'une Assemblée nationale devant décider si la guerre serait continuée ou non.
Cette assemblée vota la paix. L'une des clauses de la convention, la plus pénible pour les Parisiens, fut l'obligation de voir l'armée prussienne entrer dans leur ville et y séjourner jusqu'à la conclusion de la paix.
En effet, le 1er mars, 30 000 soldats allemands vinrent camper dans le quartier des Champs-Elysées. Ce fut un deuil public ; aucun magasin n'ouvrit et toutes les affaires furent interrompues. Les persiennes des maisons étaient fermées et dans beaucoup d'endroits des drapeaux noirs paraissaient aux fenêtres. Trois jours après les Prussiens sortirent de Paris. On ne sait ce qui se serait produit s'ils y étaient restés plus longtemps : la population continuait à protester contre la paix, demandait la guerre quand même, et peut-être le combat se fût-il engagé dans les rues mêmes de la ville.
Ainsi finit le siège de Paris ; il avait duré du 18 septembre 1870 au 28 janvier 1871, c'est-à-dire une période de 130 jours, pendant lesquels la grande ville donna au monde l'exemple d'une admirable abnégation et de toutes les vertus patriotiques. La constance, le courage avec lesquels elle souffrit les plus cruelles épreuves, la faim, le bombardement et toutes les horreurs de la guerre, font de cette résistance une des pages les plus glorieuses de l'histoire de Paris.
Il est presque impossible d'admettre que Paris puisse être une autre fois assiégé ; car depuis 1871 on a construit autour de la ville de nouveaux forts, grâce auxquels l'investissement deviendrait extrêmement difficile. Ces forts sont établis à une distance d'environ cinq lieues, assez grande pour laisser entre eux et les fortifications un vaste espace de champs où l'on pourrait continuer la culture maraîchère, et même parquer du bétail en vue des approvisionnements. De plus, ils sont situés sur tous les points culminants qui commandent les abords de la capitale, à Villeneuve-Saint-Georges, au plateau de Chàtillon, à Buc, à Saint-Cyr, au bois d'Arcy, à Cormeilles, à Andilly, à Chelles, à Villiers et à Chennevières-sur-Marne. Dans ces conditions, une armée d'investissement serait forcée d'avoir un effectif à peu près irréalisable.
Quelques Parisiens célèbres du dix-neuvième siècle.
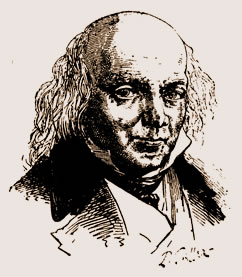
Béranger.
Béranger (1780-1857). — Le plus grand chansonnier de notre pays. Les dernières années du premier Empire lui inspirèrent des chants patriotiques que la France entière répéta. Il fut, dès lors, considéré comme notre poète national. Le gouvernement de la Restauration le condamna à l'amende et à la prison. En 1848, envoyé malgré lui à l'xAssemblée constituante par les électeurs parisiens, il ne tarda pas à donner sa démission. Il mourut en 1857 ; le gouvernement lui fit faire, aux frais de l'État, de magnifiques funérailles.
Courier (Paul-Louis), (1772-1825). — Helléniste et pamphlétaire célèbre. Il prit part, comme officier d'artillerie, à quelques campagnes en Allemagne et en Italie jusqu'en 1809. C'est à Florence qu'il retrouva, dans un manuscrit du roman de Longus, Daphnis et Chloé, un passage qui avait échappé à tous les savants. Rentré en France en 1814, il épousa la fille de l'helléniste Clavier. Dès la Restauration, personnifiant en lui tous les droits méconnus et toutes les libertés violées, il remplit la France de ses admirables pamphlets, dont le plus célèbre est intitulé : Pamphlet des pamphlets. Poursuivi et emprisonné, il n'en devint que plus ardent à la lutte. Il mourut en 1825, assassiné par son garde-chasse, à l'instigation, a-t-on dit, de ses ennemis politiques ; mais la lumière n'a jamais été faite sur ce crime.
Musset (Alfred de), (1810-1857). — Poète et prosateur. Ses œuvres les plus connues sont, outre ses Poésies, la Confession d'un enfant du siècle et un recueil de Comédies et proverbes. Il entra à l'Académie française en 1852. Sa place est marquée parmi les grands poètes, à côté de Lamartine et de Victor-IIugo.
George Sand (Mme), (1804-1876). — Écrivain remarquable, auteur d'un grand nombre de romans célèbres ; citons seulement la Petite Fadette, la Mare au Diable, François le Champi, le Marquis de Villemer, les Beaux Messieurs de Bois Doré, etc.
Sue (Eugène), (1801-1857). — Un de nos plus féconds romanciers. Après avoir publié, depuis 1831, des romans et des articles de journaux ou de revues de caractères divers, il entreprit, à partir de 1842, une série d'œuvres politiques et sociales, dont les plus célèbres sont : les Mystères de Paris, le Juif errant, Martin ou l'Enfant trouvé, les Sept péchés capitaux, et enfin les Mystères du peuple. Élu à l'Assemblée législative en 1850, il se retira à Annecy lors du coup d'État de 1851. Eugène Sue est surtout remarquable par l'imagination et l'art de mettre en scène ; son style est le plus souvent diffus.
Littré (Émile), (1801-1881). — Philologue de premier ordre, doué d'une érudition universelle. Son grand Dictionnaire de la langue française est un des travaux les plus importants et les plus remarquables du dix-neuvième siècle. Littré, qui était membre de l'Académie de médecine, a donné une traduction des œuvres d'Hippocrate (1839-1851) en 7 volumes, la seule faisant autorité aujourd'hui. Il fut un des plus fervents disciples d'Auguste Comte, le fondateur de la doctrine positiviste.
Michelet (1798-1874). — Outre ses deux œuvres capitales, l'Histoire de France et l'Histoire de la Révolution, il a écrit de charmants ouvrages intitulés : l'Insecte, l'Oiseau, la Mer, etc. Si certaines de ses opinions sont sujettes à controverse, son œuvre tout entière respire le plus ardent patriotisme. Le style, quoique souvent heurté, est empreint d'une rare originalité et d'une chaleur qui s'élève parfois jusqu'au lyrisme.
Villemain (1790-1870). — Savant professeur et littérateur ; membre de l'Académie française. Outre son Cours de littérature, professé à la Sorbonne, il a laissé un grand nombre d'ouvrages d'histoire et d'érudition, entre autres, les Mélanges historiques et littéraires.
Merimée (Prosper), (1803-1870). — A écrit un grand nombre de Nouvelles, dont quelques-unes sont des chefs-d'œuvre. On peut citer, parmi les plus connues, Colomba, Carmen et la Prise de la Redoute.
Murger (Henri), (1822-1861). — Romancier de talent. A vécu d'une façon bizarre. Il a retracé les détails de cette existence dans les Scènes de la vie de Bohême. Il a donné en 1851, au Théâtre-Français, une charmante comédie en 1 acte intitulée : le Bonhomme Jadis. Murger manque souvent d'art dans la composition, et son style se ressent parfois du décousu de son existence.
Cavaignac (1802-1857). — Général et homme politique. En 1848, il reçut de l'Assemblée la mission d'étouffer la formidable insurrection de Juin. Après la victoire, il fut nommé par acclamation chef du pouvoir exécutif, et on déclara qu'il avait bien mérité de la patrie. Le 20 décembre 1848 il descendit du pouvoir avec dignité. Arrêté au coup d'État de 1851, il fut relâché quelques temps après et rentra dans la vie privée.
Scribe (Eugène), (1791-1861).—Le plus fécond des vaudevillistes français. Il n'a pas écrit moins de 350 pièces de tous genres, qui portent toutes le cachet du maître, quoique dans la plupart de ces œuvres il ait eu des collaborateurs. Scribe, qui était membre de l'Académie française, occupera une large place dans l'histoire du théâtre au dix-neuvième siècle.
Cousin (Victor), (1792-1867). — Un des plus grands écrivains et des plus grands philosophes de notre temps. Professeur à la Sorbonne dès 1815, où il succéda à Royer-Collard, Cousin devint, en 1830, membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique et directeur de l'École normale supérieure. En 1833, il fut le rapporteur h la Chambre des pairs de la loi sur l'instruction primaire. Il prit sa retraite en 1852 et publia, à partir de cette époque, d'admirables études sur la société du dix-septième siècle, telles que la Jeunesse de Mazarin et la Jeunesse de Mme de Longueville. Les points fondamentaux de sa doctrine philosophique se trouvent résumés dans le volume intitulé : du Vrai, du Beau et du Bien. Cousin était membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. En dehors de ses œuvres philosophiques propres, qui comprennent plusieurs volumes, il a publié une traduction de Platon, qui, si elle ne suit pas toujours rigoureusement le texte, n'en est pas moins remarquable par le style.
Berryer (1790-1868). — Un des plus grands orateurs du siècle. Avocat et homme politique, il se fit de bonne heure un nom dans les assemblées comme orateur du parti légitimiste. Il a plaidé dans la plupart des causes célèbres. Les typographes de Marseille, qu'il avait défendus en 1860, lui offrirent un volume des Oraisons funèbres de Bossuet, composé à son intention, et dont il ne fut tiré qu'un seul exemplaire.
Hérold (1791-1833). — Compositeur français. Ses deux chefs-d'œuvre sont Zampa et le Pré aux Clercs.
Halévy (Fromenthal), (1799-1862).— Compositeur français. Ses principaux chefs-d'œuvre sont la Juive, la Reine de Chypre, le Val d'Andorre, les Mousquetaires de la Reine, l'Eclair.
Adam (Adolphe), (1803-1856). — A écrit un grand nombre d'opéras-comiques restés populaires. Les plus connus sont : le Châlet, le Postillon de Longjumeau, le Toréador, Si j'étais Roi, etc.
David (Louis), (1748-1825). — Un des plus grands peintres de l'école française ; il exerça une influence décisive, non seulement sur la peinture, mais encore sur l'architecture de la fin du dix-huitième siècle et du commencement du dix-neuvième, en puisant ses inspirations dans l'antiquité grecque. Il fut, avec Ingres et Gros, le peintre officiel de Napoléon Ier.
Delacroix (Eugène). (1799-1863). — Célèbre peintre, remarquable surtout par la vigueur de son coloris. Il inaugura, dans la peinture, la lutte des romantiques et des classiques, entamée pour la littérature par Victor Hugo.
Corot (1796-1875). — Un des meilleurs peintres paysagistes de l'école française contemporaine. Parmi ses toiles les plus remarquables, on peut citer le Gué et la Queue d'étang à Ville-d'Avray, qui sont deux chefs-d'œuvre.
Regnault (Henri), né en 1843. — Peintre d'un grand talent. Il fut tué à peine âgé de 28 ans, à la bataille de Buzenval, le 19 janvier 1871.
En outre, de nombreux auteurs ou artistes contemporains, dont le nom est maintenant célèbre, sont nés à Paris. Parmi eux, nous pouvons citer MM. Dumas fils, Labiche, Legouvé, Sardou, Vacquerie, Gounod, etc.
Paris sous la troisième République.
Bien que cette histoire s'arrête à l'année 1870, il convient de rappeler d'un mot que la troisième République s'est préoccupée, à l'égal des gouvernements qui l'ont précédée, d'embellir et d'assainir Paris. De nombreuses écoles, des casernes de sapeurs-pompiers, etc., ont été construites ; des voies nouvelles ont été percées, telles que le boulevard Saint-Germain, l'avenue de l'Opéra, la rue Etienne-Marcel. Des promenades, comme le parc de Montsouris, et de nouveaux squares ont été ouverts au public dans les quartiers populeux. Enfin, depuis 1870, Paris a été doté de monuments nouveaux, tels que le palais duTrocadéro, l'Hôtel des Postes et l'Hôtel-de-Ville reconstruit. De grands travaux d'assainissement ont également été entrepris.
Après bien des vicissitudes, après de cruelles épreuves dont les dernières remontent à peine à quelques années, Paris n'a point déchu du rang qu'il a toujours occupé à la tête des grandes capitales ; plus que jamais, il peut étaler avec fierté la devise inscrite clans ses armes, au-dessous du vaisseau qui porte la fortune des Parisiens sur les flots agités : Fluctuat nec mergitur. « Il flotte et n'est jamais submergé. »

Table des matières
Livre Premier — Histoire de Paris
I. Lutèce. — Paris gallo-romain.
II. Paris sous les Mérovingiens et les Carolingiens.
IV. Paris sous Philippe-le-Bel
V. Paris sous les Valois. — Philippe VI et Jean le Bon.
VI. Paris sous les Valois. — Charles V.
VII. Paris sous les Valois. — XVe siècle.
VIII. Paris sous les Valois. — XVIe siècle.
IX. Paris sous les Bourbons. — Henri IV, Louis XIII.
X. Paris sous les Bourbons. — Louis XIV.
XI. Paris sous les Bourbons. — Louis XV.
XII. Paris sous les Bourbons. — Louis XVI.
XIII. Paris sous la Révolution.
XV. Paris sous la Restauration.
XVI. Paris sous Louis-Philippe.
XVII. Paris sous la République de 1848.
XVIII. Paris sous le second Empire.
XIX. La guerre de 1870.
Livre II — Monuments de Paris
II. Architecture romane (époque capétienne).
IV. La Renaissance.
V. L'architecture au XVIIe siècle.
VI. L'architecture au XVIIIe siècle.
VII. L'architecture au XIXe siècle.
VIII. L'architecture, de 1848 à nos jours.
Livre III — Administration
I. Généralités.
II. Administration municipale. — Autrefois.
III. Administration municipale. — Aujourd'hui.
IV. Voirie. — Boulevards, rues, places, etc. — Circulation. — Cimetières. — Éclairage.
V. La Seine. — Canaux. — Eaux potables. — Égouts.
VII. Enseignement. — Bibliothèques.
VIII. Musées. — Théâtres.
X. Police. — Prisons. — Pompiers.
XI. Grands établissements parisiens.
Paris et les parisiens.
Les environs de Paris.